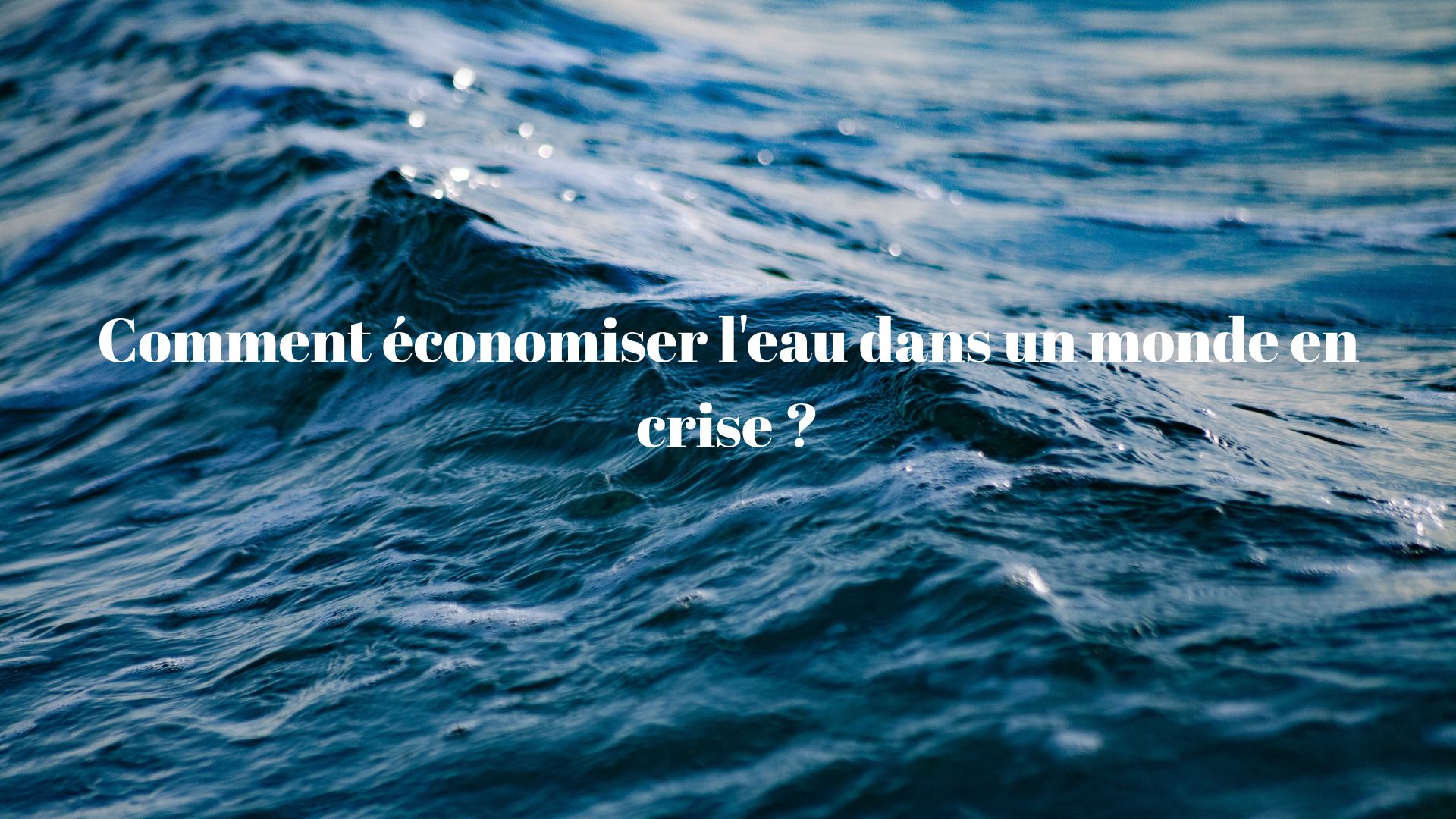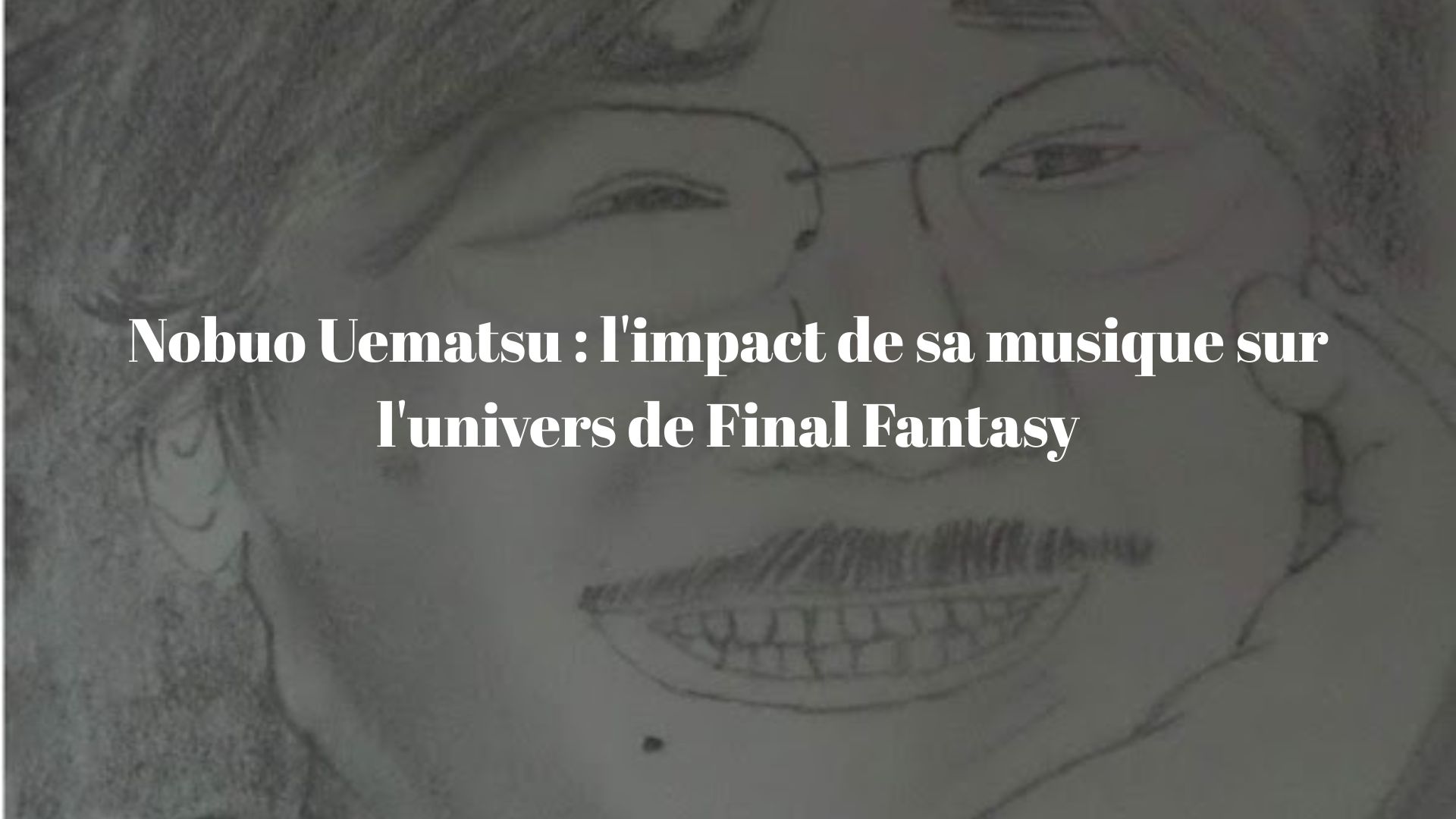Totoro, la mort et les enfants : et si Ghibli nous avait menti ?
Sous ses airs de conte bucolique, Mon Voisin Totoro cacherait-il une réalité bien plus sombre ? Mort, hallucination, affaire criminelle… Le film culte de Miyazaki fait l’objet de théories dérangeantes. À travers une plongée dans l’imaginaire, le symbolisme et les faits, explorons ce qui rend ce film pour enfants si… troublant.
Depuis sa sortie en 1988, Mon Voisin Totoro s’est imposé comme un chef-d’œuvre du cinéma d’animation. Univers poétique, forêt enchantée, esprit protecteur à gros ventre… tout semble taillé pour émerveiller les enfants. Pourtant, derrière les rires de Satsuki et les fugues de May, certains spectateurs ont vu autre chose : des ombres, des non-dits, et des signes de mort.
Des théories émergent, dérangent, et persistent, au point que Totoro est aujourd’hui devenu, bien malgré lui, un sujet d’étude pour les amateurs de thrillers psychologiques, de légendes urbaines, et de folklore japonais sinistre. Alors, simple interprétation exagérée ? Ou chef-d’œuvre morbide maquillé en film pour enfants ? Il est temps de décortiquer ce classique en apparence inoffensif. Spoiler : vous ne reverrez plus le Chat-Bus de la même façon.
Totoro, dieu de la mort ou esprit bienveillant ?
Totoro est présenté comme un esprit de la forêt. Il vit dans un camphrier géant, fait pousser des arbres à la vitesse de l’éclair et n’émet que des grognements mignons. Mais une théorie récurrente sur les forums, blogs et vidéos YouTube affirme que Totoro n’est pas un esprit protecteur, mais un dieu de la mort.
La théorie trouve son origine dans un fait simple mais glaçant : seules les filles peuvent le voir. Les adultes, eux, restent aveugles à sa présence. Pire encore, il apparaît pour la première fois quand la mère de Satsuki est gravement malade. Totoro serait alors une sorte de guide entre la vie et la mort, apparaissant uniquement aux enfants dont l’âme est en danger.
Une inspiration venue du folklore japonais ?
Dans le shintoïsme, les esprits appelés kami ne sont pas forcément bons ou mauvais. Ils peuvent être les deux, selon les circonstances. Totoro, avec son comportement impassible, son regard fixe et son lien avec la nature et la nuit, correspond étrangement au profil de Shinigami, des entités qui guident les morts.
Ajoutez à cela le Chat-Bus — cette créature féline qui peut se rendre visible ou non, transporter les enfants mais jamais les adultes, et qui disparaît dans les bois sans laisser de trace — et vous obtenez un cortège funèbre particulièrement poilu.
Une icône douce… ou glaçante ?
Ce contraste entre l’apparence de Totoro (moelleux, rond, quasi pelucheux) et sa supposée fonction (psychopompe céleste) nourrit l’inconfort du spectateur. Il est à la fois familier et surnaturel, comme ces créatures que les enfants inventent pour se rassurer… ou pour mieux faire face à l’inacceptable.
Le doute plane. Totoro est-il une invention de l’enfance ? Une présence bienveillante dans un monde cruel ? Ou bien le dernier visage que l’on voit avant de quitter ce monde ? Ce n’est que le début des suppositions…
Des indices cachés dans l’animation : quand le décor parle
Miyazaki est un maniaque du détail. Chaque plan, chaque couleur, chaque ombre semble pesé, mesuré, codé. Et comme souvent chez les génies, ce perfectionnisme graphique nourrit les théories les plus obscures. Car si l’on prend le temps de regarder Mon Voisin Totoro autrement, certains éléments visuels deviennent carrément dérangeants.
L’ombre de la mort partout dans les décors ?
Dès les premières scènes, l’ambiance est étrange. La maison est vétuste, isolée, presque hantée. Le plafond menace de s’effondrer, les portes grincent, des boules de suie (les susuwatari) fuient à toute vitesse comme si la présence des humains était une intrusion… ou une erreur. Ce sont peut-être les seuls à avoir senti que cette maison n’est pas normale.
Dans les scènes de forêt, tout semble d’un calme presque surnaturel. Les couleurs virent au vert profond, au bleu froid. La lumière est douce, presque cotonneuse, comme un rêve… ou un passage vers autre chose. Totoro apparaît la nuit, dans le silence, à côté d’un arbre dont le tronc rappelle un tombeau. Et quand il rugit, c’est un son sourd, profond, quasi souterrain.
La scène du bus : ambiance nécrologique
Lorsque Satsuki attend son père sous la pluie, seule à l’arrêt de bus, c’est l’une des scènes les plus célèbres du film. Et l’une des plus froides : aucune musique, aucun dialogue, juste le clapotis de la pluie et le tonnerre au loin. Totoro apparaît derrière elle, sans un mot, tenant une feuille comme parapluie. Cette scène a été analysée des dizaines de fois comme un passage rituel : deux êtres silencieux, attendant un transport… vers l’au-delà ?
Et puis il y a le Chat-Bus. Il ne fait pas que se déplacer rapidement : il traverse la réalité, glisse dans l’obscurité, s’efface dans la brume. Les inscriptions sur sa destination ? Parfois floues, parfois absentes. Comme si ses arrêts n’étaient connus que des morts.
Les vêtements, les regards, les non-dits
Un autre détail glaçant : dans certaines scènes clés, les filles ne projettent plus d’ombre. Ce genre de détail ne peut pas être accidentel dans une production Ghibli.
De plus, après la disparition de May, lorsqu’on retrouve sa chaussure, la réaction de Satsuki est anormalement froide. Comme si elle refusait déjà d’accepter la mort, ou… qu’elle savait.
Et puis il y a la fameuse scène de fin, lorsque les deux filles visitent leur mère depuis un arbre, sans jamais entrer dans l’hôpital. Elles la regardent de loin, comme des esprits bienveillants. Leur mère murmure qu’elle croit les avoir vues. L’hôpital semble paisible… trop paisible.
L’affaire Sayama : la vérité derrière le mythe Totoro ?
Depuis des années, une rumeur persistante lie le film Mon Voisin Totoro à un fait divers survenu en mai 1963 à Sayama, dans la préfecture de Saitama, au Japon. Le lien ? Trouble. Les preuves ? Zéro. L’ambiance ? Glaciale.
Et pourtant, les coïncidences sont si nombreuses qu’elles alimentent encore aujourd’hui des centaines de blogs, de vidéos et de nuits blanches.
Le fait divers : kidnapping, meurtre et suicide
Le 1er mai 1963, une lycéenne de 16 ans, Yoshie Nakata, est kidnappée alors qu’elle rentre chez elle. Sa famille reçoit une demande de rançon. Malgré le paiement, la jeune fille est retrouvée violée et assassinée. Peu après, sa sœur aînée, accablée par la culpabilité de ne pas avoir pu la protéger, se suicide.
Un drame. Un de ces faits divers insoutenables qui laissent une trace dans la mémoire collective. Et dont certains pensent qu’il aurait inspiré Ghibli, volontairement ou non, pour créer Mon Voisin Totoro.
Les similitudes troublantes
Les deux filles du film, Satsuki et May, seraient les équivalentes symboliques des sœurs de l’affaire Sayama.
Le prénom May lui-même est un indice : en anglais, May signifie mai, le mois du drame. Une coïncidence ? Peut-être. Ou peut-être pas, si l’on observe :
- L’action du film se déroule en mai.
- Le film évoque la disparition d’une petite fille.
- La scène de la chaussure retrouvée dans l’étang fait écho au moment où le corps de Yoshie est retrouvé.
- La réaction silencieuse et choquée de la sœur survivante ressemble à un état dissociatif.
Et puis, il y a Totoro lui-même. Si on l’interprète comme un psychopompe (passeur d’âmes), alors sa présence après la disparition de May prend une dimension macabre. Le Chat-Bus, avec ses déplacements invisibles, ses passagers éphémères et ses destinations floues, devient un véhicule pour les âmes perdues.
Une théorie niée par le studio… mais jamais oubliée
Ghibli a officiellement démenti tout lien entre Totoro et l’affaire Sayama. Ce que l’on peut comprendre : associer son plus grand succès familial à un crime sordide serait suicidaire.
Mais les fans n’en démordent pas. Le silence poétique du film, son rythme suspendu, et ses ellipses narratives leur donnent le goût du deuil et du rêve mêlés. Comme si, à chaque visionnage, on participait à une forme de deuil réparateur, symbolique, qui adoucit une tragédie réelle.
May est-elle morte ? La disparition qui fait vaciller le film
C’est le point de bascule du récit. May, la cadette, disparaît. Elle part seule avec un épi de maïs pour voir sa mère à l’hôpital. On la cherche, on crie son nom, la panique monte. On retrouve une chaussure. Pas May.
Et pendant une bonne partie du film, May est littéralement absente. Elle n’est plus visible par les humains. Jusqu’à ce que Totoro l’emmène en chat-bus express vers l’hôpital, où elle et Satsuki n’interagissent plus avec personne.
Les théoriciens du drame s’en donnent à cœur joie.
La scène du lac : une chaussure, un indice, un silence
Lorsque les villageois trouvent une petite chaussure dans l’étang, ils craignent que ce soit celle de May. Satsuki nie. Elle hurle : « Ce n’est pas à elle ! » Mais… pourquoi ce déni si ferme ?
Rien ne confirme que ce n’est pas sa chaussure. Et la réaction est trop rapide, presque comme si elle refusait une réalité insupportable.
Ce moment est crucial. Car à partir de là :
- Satsuki se tourne vers Totoro pour l’aider. Pas vers les adultes.
- Les deux sœurs deviennent les seules à voir le Chat-Bus.
- Elles apparaissent perchées dans un arbre, regardant leur mère sans jamais lui parler.
Fantômes ou enfants heureux ?
La théorie veut que May soit morte, noyée. Et que Totoro, en tant que passeur, aide Satsuki à la rejoindre pour l’accompagner dans l’au-delà.
La scène à l’hôpital est souvent interprétée comme un adieu fantomatique. Les filles sont là, mais inaccessibles. Leur mère les perçoit vaguement, comme des souvenirs heureux. Elles rient, elles s’éloignent. Comme des âmes libérées.
Un détail visuel renforce cette interprétation : dans cette scène, les deux sœurs ne projettent plus d’ombre. Ni sur le toit de l’hôpital. Ni ailleurs.
Dans une animation aussi méticuleuse que celle du studio Ghibli, ce n’est pas une erreur.
Et après ? Rien. Juste un générique
Le film se termine sans conclusion claire. Le générique montre des scènes quotidiennes : la mère rentre à la maison, la vie reprend… mais les filles n’interagissent plus avec le monde réel. Tout semble suspendu dans une forme de rêve mélancolique.
Alors, May est-elle morte ? Le film ne tranche jamais. Et c’est justement cette zone grise qui nourrit les fantasmes.
Les petites filles sont-elles folles ? Folie douce ou dissociation sévère ?
Satsuki et May vivent une situation traumatisante : leur mère est hospitalisée pour une maladie grave (jamais nommée, mais fortement suspectée d’être une tuberculose). Leur père, professeur, est absent une bonne partie de la journée. Elles sont isolées, déplacées dans une maison inconnue, au milieu de nulle part.
Et surtout : elles n’ont pas d’adultes pour encadrer leurs émotions.
Il est donc légitime de se demander : et si Totoro n’était qu’une hallucination partagée ?
L’imaginaire comme mécanisme de survie
La psychologie infantile est formelle : face à un traumatisme, les enfants créent des mondes parallèles. C’est une réponse saine… tant qu’elle ne prend pas le pas sur la réalité.
Ici, les éléments sont troublants :
- Totoro n’interagit jamais avec un adulte.
- Le Chat-Bus est invisible aux yeux des autres.
- Même les susuwatari fuient quand le père entre.
- Les adultes ignorent les aventures surnaturelles que vivent les filles.
Tout le récit pourrait alors se lire comme une construction mentale, un exutoire pour fuir la peur de la perte. Totoro serait l’ami imaginaire géant, rassurant, inoffensif, qui protège sans condition.
Une dissociation ?
Dans certaines scènes, surtout après la disparition de May, Satsuki semble changer. Elle devient froide, parle de moins en moins. Elle court, seule, épuisée, implore Totoro dans une crise quasi mystique.
On pourrait voir là une dissociation : un détachement du réel causé par le stress extrême.
Elle entre alors en communication avec un être invisible, appelle un Chat-Bus, vole dans les airs… ou croit le faire.
Ce n’est plus de l’imagination ordinaire. C’est un repli total.
Et si elles partageaient un trouble ?
Certains vont plus loin : et si Satsuki et May étaient toutes deux atteintes d’un trouble psychiatrique partagé, type folie à deux ? Ce phénomène rare mais documenté pousse deux individus, généralement proches, à partager un même délire ou une hallucination.
Leur isolement, leur lien fusionnel, la pression psychologique… tous les éléments sont là. Totoro, le Chat-Bus, les rituels forestiers ? Des constructions délirantes communes pour survivre à l’attente, à l’angoisse, à la solitude.
Pourquoi les enfants dès 4 ans peuvent-ils voir un film aussi dérangeant ?
Sur le papier, Mon Voisin Totoro est un film d’animation doux, lumineux, avec ses créatures rondes et son univers champêtre. Pourtant, sous cette apparence candide, se cache un monde parfois lourd, mélancolique, et surtout rempli de symboles sombres.
Alors pourquoi la classification officielle le destine-t-elle aux tout-petits ? Et pourquoi des millions de parents l’acceptent sans sourciller ?
Le paradoxe de la culture japonaise
Au Japon, la frontière entre monde réel et surnaturel est beaucoup plus fluide que chez nous.
Les esprits, les fantômes, les dieux de la nature font partie intégrante de la culture populaire, sans forcément être effrayants. Ils représentent souvent une connexion à la nature, à la mémoire, à la vie et la mort, dans un même souffle.
Mon Voisin Totoro est ainsi un conte, une fable où les enfants apprennent à gérer leurs peurs, à vivre avec l’absence, à comprendre la maladie et la mort sans en être traumatisés.
Un récit initiatique déguisé
Le film est construit comme un rite de passage. Satsuki et May traversent un univers où elles doivent affronter la solitude, la peur, la disparition. Le fantastique leur offre une évasion, mais aussi une résilience.
L’exposition précoce à ces thèmes via une métaphore douce et visuelle est un moyen pour l’enfant de comprendre l’incompréhensible sans traumatisme frontal.
Un équilibre subtil
La douceur des musiques, les couleurs pastel, les personnages non menaçants, la simplicité narrative… tout est fait pour rassurer.
Mais les ombres sont là. Ce mélange offre à l’enfant une première expérience de l’ambiguïté émotionnelle, une initiation à la complexité de la vie.
Le rôle du parent
Enfin, au Japon comme ailleurs, la présence d’un adulte lors du visionnage est cruciale. Les enfants peuvent poser leurs questions, recevoir des explications adaptées à leur âge. C’est une immersion accompagnée, pas un visionnage solitaire.
Mon Voisin Totoro n’est pas qu’un film d’animation pour enfants au charme bucolique. C’est une œuvre douce-amère, tissée de mélancolie et de silences, qui joue sur les frontières floues entre réalité, imaginaire, vie et mort.
La disparition de May, la présence énigmatique de Totoro, et l’univers presque onirique dessinent un conte à double lecture.
Celui d’une famille confrontée à la peur de la perte, d’enfants qui inventent des mondes pour ne pas sombrer, et peut-être, d’âmes errantes guidées vers la lumière.
Les théories folles sur la mort de May ou la folie des filles, bien qu’infondées officiellement, parlent à notre besoin humain de donner du sens à l’inexpliqué, au tragique caché sous le vernis du conte.
Que vous regardiez Totoro comme un rêve d’enfance ou une énigme sombre, une chose est sûre : ce film est une invitation à regarder au-delà des apparences. Et à accepter que parfois, la lumière la plus pure vient des ombres les plus profondes.